1. Comment la famine et le manque de nourriture à Gaza peuvent-ils affecter la santé des générations futures ainsi que l’écosystème humain et naturel de la région ?
La famine et la malnutrition aiguë à Gaza, qui touche plus d'un enfant sur cinq (selon l'OMS), auront des conséquences profondes sur la santé des générations à venir. Il est de notoriété publique que chez les enfants, la malnutrition entrave la croissance physique et le développement cérébral, augmente les risques de maladies chroniques comme le diabète et les affections cardiaques à l'âge adulte, pour ne pas parler des pathologies induites par la violence, la souffrance le stress chronique. Chez les femmes enceintes, elle provoque des naissances de faible poids, perpétuant un cycle intergénérationnel de vulnérabilité : les enfants sous-alimentés deviennent des parents à risque, transmettant des déficits nutritionnels et des troubles métaboliques (effets épigénétiques). Des études sur des famines passées montrent que ces effets persistent sur plusieurs générations, affectant la productivité et la résilience cognitive des populations. Les plus célèbres de ces études ont porté sur les pathologies épigénétiquement induites et touchant les survivants des famines en Hollande ou Leningrad pendant la dernière guerre mondiale.
Sur le plan de l'écosystème humain, cela vient évidemment s’ajouter à la pauvreté, la souffrance, les amputations pédiatriques massives et les expositions environnementales toxiques dues à la guerre. Cela mène à une souffrance prolongée qui s'installe chroniquement dans la culture et les représentations collectives et dont on mesure pas les effets, sauf si on s'intéresse à l'évolution des représentations collectives dans les populations historiquement soumises à des stress chroniques dans leur histoire (si vous voyez ce que je veux dire). Bref, c'est la perpétuation et la contagion de la souffrance.
Pour l'écosystème naturel, la destruction de plus de 60 % des terres agricoles, des serres, des élevages et des pêcheries a ruiné les chaînes d'approvisionnement alimentaires, polluant les sols et les eaux par les déchets et les munitions non explosées. La Palestine était l'un des premiers producteur mondiaux d'agrumes en 1920, contrairement au mythe d'Israël qui fait "reverdir le désert", la colonisation et la destruction méthodique de la culture vivrière des autochtones par la destruction des sources, le tronçonnage des oliviers, l'urbanisation massive via des concentrations urbaines archi-dépendantes au détriments de populations engagées dans des modes de production vivrières autosuffisantes, et j'en passe, transforment cette région déjà fragile, en enfer pour la vie libre, ou ce qu'il en reste.
2. Comment les organisations, les pays et les institutions internationales peuvent-ils empêcher que la situation à Gaza se détériore sous l’effet des actions d’Israël ?
Les organisations internationales comme l'ONU, l’OMS et d’autres, appellent à un accès humanitaire ininterrompu et constant pour éviter une détérioration rapide, en exigeant la levée des obstructions à l'aide, qui ont multiplié par quatre les cas de malnutrition infantile en deux mois. Mais l'ONU ne s'est pas décolonisée encore et on voit avec quelle insistance, les Etats-Unis bloquent toute solution avec le lâche soutien des diplomaties occidentales
1. La pression des forces des BRICS, jusqu'ici peu actives, pourrait faire basculer l'équilibre. Des initiatives diplomatiques revitalisées, soutenues par l'UNSCO, visent à coordonner les efforts multilatéraux pour un cessez-le-feu et une reprise des livraisons d'aide, avec plus de 62 000 tonnes mensuelles nécessaires pour couvrir les besoins de base. Les pays donateurs, via des mécanismes comme le WFP, peuvent intensifier les financements pour des corridors humanitaires sécurisés et des inspections accélérées des convois. Les institutions comme le Comité des droits de l'enfant de l'ONU condamnent les restrictions et poussent pour des sanctions ciblées ou des enquêtes sur les violations du droit international, tout en plaidant pour une protection civile accrue. Des efforts conjoints, comme ceux du Croissant-Rouge palestinien, incluent des dépistages nutritionnels et des distributions d'urgence, mais nécessitent une pression collective sur Israël pour passer d'un flux d'aide "goutte à goutte" actuellement utilisé pour alimenter la violence interne entre palestiniens pour l'accès aux ressources, vers un approvisionnement stable, évitant ainsi une famine généralisée. La clé c'est l'opinion publique mondiale. Pour gagner cette bataille, il faut sortir le soutien au civils palestiniens des goulots d'étranglement politiques, communautaires et idéologiques. C'est la transformation de la cause en "cause d'extrême-gauche" par les relais médiatiques d'Israël, parfois avec le concours de ses soutiens, qui bloque encore un accord unanime de la population sur la nécessité de faire cesser cette incroyable politique de destruction d'un peuple entier. On voit que c'est ce que craint le plus Benjamin Netanyahou, comme l'indiquait récemment des publications de Wikileaks. Israël perd même son soutien dans la base MAGA pro-Trump aux Etats-Unis. Les implications pourraient être décisives. C'est le basculement que nous devons favoriser et chacun doit en déduire les implications. Le sectarisme engendré inéluctablement par les affiliations politiques limite la viralité de la prise de conscience. Ouvrons cette cause avec ceux qui ne partagent pas nos options sociales, politiques, idéologiques ou esthétiques. Chaque jour nous éloigne d’une solution acceptable. Pour le moment, ce n’est pas une pression collective sur Israël qui s’exerce mais Israël qui exerce une pression collective sur l’opinion publique mondiale. C’est l’étau qu’il faut desserrer !
3. Quelles mesures pourraient garantir simultanément la sécurité alimentaire et la protection de l’environnement dans des zones assiégées comme Gaza ?
Comme partout, pour concilier sécurité alimentaire et protection environnementale, des plans à long terme doivent viser à restaurer l'autosuffisance agricole en revitalisant les terres cultivables, les serres et les pêcheries, tout en intégrant des pratiques durables comme l'irrigation goutte-à-goutte pour économiser l'eau polluée. Ce territoire devient inhabitable. Terminer le blocus et la guerre permettrait de rétablir l'accès aux technologies et intrants agricoles écologiquement viables pour des semences autochtones régionales. Des solutions hybrides, comme des projets d'aquaculture durable et de recyclage des déchets pour l'énergie, réduiraient la dépendance aux importations tout en minimisant la pollution des sols et des eaux usées. Protéger le droit à l'alimentation implique des dispositions pour empêcher la destruction des zones tampons agricoles, favorisant une résilience communautaire via des coopératives locales qui restaurent les habitats tout en produisant de la nourriture locale. Mais évoquer ces solutions dans cette région dévastée, affamée, colonisée et broyée relève presque de la fiction aujourd'hui. Priorité numéro un : obtenir la victoire dans l'opinion publique.
4. La crise alimentaire à Gaza est-elle aggravée par les changements climatiques dans la région ? Quelles mesures pourraient réduire à la fois la crise humaine et les problèmes environnementaux ?
J’ai envie de vous dire que cette question est aujourd'hui hors de propos à Gaza. Mais bon, tentons quand même d'y répondre, après tout c’est mon métier de brasser des données scientifiques pour produire de l’aide à la décision. Trois enjeux : la pluviométrie, le niveau de la mer et les températures.
La pluviométrie est plutôt en hausse. L'analyse de Mann-Kendall
2 montre que les pluies annuelles à Gaza ont augmenté un peu partout (à toutes les 7 stations météo : Beit-Hanon, Beit-Lahia, Remal, etc.) sur la période 1974-2016 (une tendance linéaire moyenne de +1,17 mm par an). Plus récemment, la saison des pluies 2023-2024 a enregistré des précipitations supérieures à la moyenne (plus de 120 % de la normale) dans les zones nord et centrales d'Israël et de Palestine. Bref. pas de souci ici.
Le deuxième point est l'augmentation du niveau de la mer. Selon des données disponibles, le rythme global de l'élévation du niveau de la mer a doublé depuis les années 1990, passant d'environ 2,1 mm par an en 1993 à 4,5 mm par an en 2024. Entre 1992 et 2022, l'élévation a atteint 14,59 cm dans l’ensemble du bassin méditerranéen
3 . Je ne veux pas négliger l'effet d'une augmentation de 0,5 cm du niveau de la mer par an du tout. On sait qu'à Gaza, une hausse de 0,37 m du niveau de la mer entraînerait une intrusion d'eau de mer dans l'aquifère de 30 à 70 mètres supplémentaires
4 , qui aggravera inévitablement la salinisation des eaux souterraines déjà critique (95 % de l'eau est impropre à la consommation
5 ). Mais au stade où nous en sommes, ces données de long terme (74 ans) sont hors de vue pour ses habitants qui tentent de survivre.
Enfin dernier point, les températures. La température moyenne annuelle en Palestine (incluant Gaza) a augmenté de 0,3 °C par décennie entre 1961 et 2015. Sur une période de 50 ans (5 décennies), cela représente une hausse cumulée d'environ 1,5 °C. Là encore, cette réalité est faussée puisque nous ne pouvons nous référer qu'à des relevé issus de stations qui sont toutes dorénavant en zones urbaines du fait de la concentration de population. Ce changement d'écosystème affecte les relevés de température de façon importante et ne permet pas de disposer de relevés spécifiques et fiables à Gaza. Une chose est certaine, au stade où en est cette espace, couvert de ruines, de polluants et d'humains vivant d'un expédient à l'autre dans la crainte et la violence, les questions "climatiques" font presque figure de préoccupations de technocrates écologistes plongées dans une bulle de réalité parallèle.
Si cette zone n'est pas purement et simplement vidée de sa population et transformée en bantoustan américano-israélien, il y aura évidemment des choses à faire. Par exemple, investir dans des infrastructures adaptatives comme des systèmes d'irrigation résistants à la salinité et des serres solaires réduirait les risques thermiques tout en boostant la production alimentaire. Des évaluations environnementales post-conflit pourraient permettre de trouver d’autres solutions pour minimiser les pollutions (eau, air) via le recyclage des déchets de guerre. Les efforts de restauration côtière à Gaza devront probablement se concentrer sur les zones humides comme Wadi Gaza (marais et dunes) avec des variétés locales comme les tamaris ou les herbes halophytes. Ce « oued » saisonnier est l’un des dernier espace vivant disposant d’un peu de biodiversité de cette zone et un élément clé pour la reconstitution des nappes phréatiques. Promouvoir des énergies renouvelables locales contribuerait aussi à briser le cycle de dégradation générale. Mais bon, revenons sur terre, la première dégradation que subit Gaza et sa population humaine, résulte de la guerre et de la colonisation. Ces enjeux là n'attendront pas 74 ans ou que des technos produisent des rapports pour des politiques « eco-responsables pour le climat ». A ce rythme, les habitants de Gaza seront tous morts bien avant.
Laurent Ozon
Le dimanche 5 octobre 2025.
1. La reconnaissance récente de l’Etat de Palestine par la France et quelques autres aurait pu être réalisée bien plus tôt. De là à penser que ces pays ont attendu le moment où la création d’un Etat palestinien viable n’était plus possible …
2. Ajjur, S.B.; Al-Ghamdi, S.G. Variation in Seasonal Precipitation over Gaza (Palestine) and Its Sensitivity to Teleconnection Patterns. Water 2021, 13, 667. https://doi.org/10.3390/w13050667.
3. UNEP/MAP et Plan Bleu (2020). State of the Environment and Development in the Mediterranean. Nairobi : United Nations Environment Programme (UNEP), 256 p. (ISBN : 978-92-807-3796-7). Disponible en ligne : https://planbleu.org/wp-content/uploads/2020/11/SoED-Full-Report.pdf.
4. Al-Nakhal, A. A., et al. (2025). Modeling Sea Level Rise Impacts on Sea Water Intrusion into Gaza Strip Aquifer. Annals of Hydrology and Meteorology, 7(3), AHM.MS.ID.000558. Iris Publishers. DOI : 10.33552/AHM.2025.07.000558. (Accès PDF : https://irispublishers.com/ahm/pdf/AHM.MS.ID.000558.pdf).
5. UNICEF (2017). Water Scarcity in the Gaza Strip: The Children’s Catastrophe. Cité dans divers rapports ONU, confirmant que 95 % de l'aquifère côtier est non potable en raison de la salinisation et de la contamination. (Accès via : https://www.unicef.org/mena/reports/water-scarcity-gaza-strip).

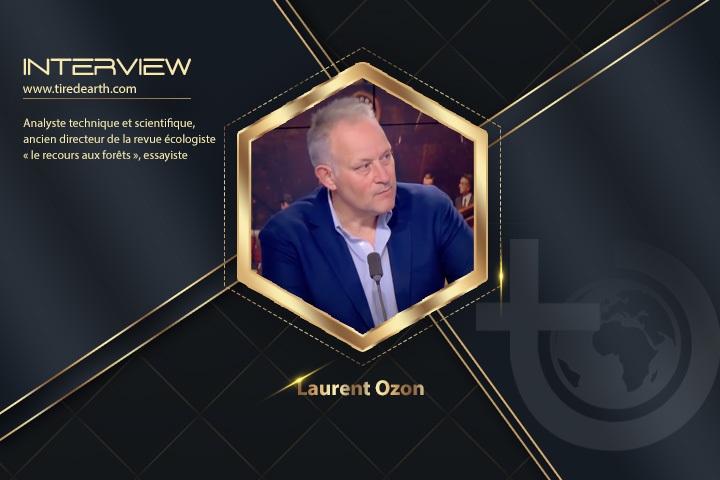
Comment